
SACRE MERDIER - MERDIER COSMIQUE
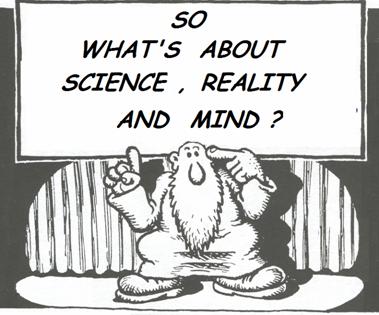
Grosso modo, la plupart des personnes et des scientifiques se partagent entre ces 2 visions, voilés que nous sommes par la dualité sujet/objet, extérieur/intérieur. La réalité des choses serait soit en « dehors de soi » soit « dans la tête ». Les scientifiques se partagent ainsi entre ces 2 visions du monde :
1) le réalisme scientifique (Démocrite, Aristote, Copernic, Képler, Galilée, Rutherford, Paul Dirac, Einstein), courant de pensée pour lequel les théories physiques ont pour objectif de décrire la réalité telle qu'elle est en soi, dans ses composantes inobservables.
2) l'instrumentalisme scientifique (Werner Heinsenberg, Max Born, Poincaré), courant de pensée pour lequel les théories ne sont que des outils servant à prédire des observations.

Les hypothèses ou prémisses de base du réalisme scientifique sont les suivantes :
Pour ceux qui ont un odorat averti et accompli cela sent tout de même un peu l’anthropocentrisme car le réalisme suppose sans sourciller que cet Univers existant indépendamment et au-delà de la pensée et des concepts humains est accessible aux concepts humains. Cela fait furieusement référence (pour des scientifiques vigoureusement athées c’est un comble) à la croyance en un Dieu Créateur de l’Univers qui nous a façonnés à sa propre image et qui s’est adressé à nous dans un langage intelligible pour nous, les mathématiques. En effet le réalisme crédite les concepts humains, mathématique ou autres, d’une capacité quasi « divine » à comprendre l’Univers. Comme quoi notre éducation ou notre environnement islamo-judéo-chrétien est inscrit au plus profond de notre esprit et modèle notre façon de penser même à l’insu de notre plein gré. La science fournirait donc des réponses sur ce qui se passe réellement dans ce monde qui nous entoure en transcendant les impressions trompeuses et subjectives de nos sens pour pénétrer au cœur de la Réalité Objective qui existe indépendamment de notre perception. Le réalisme se revendique de la réalité objective mais ses hypothèses de base qui font office de dogme sont assez discutables.
À l’opposé, selon l’instrumentalisme scientifique :
La nature ultime de la réalité de ce monde est inaccessible car ce que nous observons n’est pas la nature en soi mais une vision fragmentée et déformée par nos instruments de mesure. En effet les résultats observés sont conditionnés par le type d’instruments utilisé. L’observateur décide de quelle manière il va établir la mesure et ce dispositif expérimental déterminera, jusqu’à un certain point, les propriétés de l’objet étudié. Les théories scientifiques sont intéressantes si et seulement si elles permettent de faire des prédictions valables.
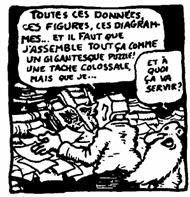 |
 |
Elles peuvent alors être appliquées sans préjuger de leur vérité ou fausseté par rapport à la réalité physique du monde. Les théories mathématiques ne sont donc que des outils servant à effectuer des prédictions justes et à organiser de manière intelligible les phénomènes observés sans que cela corresponde à une quelconque réalité matérielle. La notion de « théorie » (= principe directeur permettant de tirer des conclusions sur les phénomènes observables) disparaît au profit de celle de « modèle » (= quelque chose qui ne correspond à rien dans le monde réel mais qui est un outil d’enseignement commode à utiliser) : « la fin justifie les moyens » ou « sauvons les apparences ». Les données observées sont donc le produit de l’interaction entre l’objet observé et les éléments du dispositif expérimental. Ce processus d’identification des objets concrets conduit à admettre qu’il s’agit en fait d’objets théoriques et que le monde matériel ne contient alors aucun objet objectivement observable, cela pousse à ne plus croire à la réalité physique de quoi que ce soit. L’instrumentalisme croit donc en l’existence d’un monde objectif indépendant de notre expérience mais qui nous reste à jamais inaccessible. Nous ne pourrons donc rien savoir sur la réalité du monde qui nous entoure. L’électron peut être décrit par des quantités chiffrées fournies par des appareils de mesure (masse, vitesse, spin…). Il peut être également considéré comme une particule (masse et énergie sont alors concentrées en un endroit de l’espace, sa position est alors localisée) ou comme une onde (caractérisée par une fréquence et dont l’énergie n’est pas positionnée mais se propage dans l’espace). Il en est de même pour toute autre particule élémentaire censée constituer les briques de l’univers (neutron, proton, quarks…). C’est l’observation et la mesure qui les font apparaître sous forme de particule ou d’onde. De tous ces différents caractères, aucun ne peut être considéré comme décrivant la nature ultime de telle ou telle particule, elle reste à jamais inaccessible.
Le point commun entre ces 2 visions opposées est l’hypothèse métaphysique de base qui consiste à dire qu’il existe un monde de matière doté d’une existence autonome indépendant de notre perception et donc de notre existence. Seule une position centriste (Erwin Shroedinger, Niels Bohr, David Bohm, Eugène Wigner), peut nous garantir à la fois contre les excès du réalisme et ceux de l’instrumentalisme. Le monde qui nous entoure et que nous expérimentons nous est compréhensible intellectuellement parce que c’est à nos concepts qu’il doit d’exister. Un lien d’interdépendance lie le monde et les concepts que nous avons sur ce monde.
D'un côté, l’univers que nous observons est un monde conçu par l’être humain, un monde qui n’existerait pas sans notre présence. D'un autre côté, la disparition de notre espèce n’entraînerait pas celle de l’Univers ni celle de tous les autres êtres sensibles. Les mondes expérimentés par les autres créatures vivantes continueraient d’exister par rapport à elles. C’est le concept de « l’Univers en participation » dû à l’interaction entre la conscience et les objets qu’elle appréhende.
Pour comprendre la nature de cette participation il faut connaître aussi bien l’esprit que le monde de la matière. (image : chacun de nous correspond à une ampoule émettant une lumière dans une gamme de fréquence nous faisant tous expérimenter le même environnement lumineux. La mort d’un individu-ampoule correspond à une lumière qui s’éteint ce qui n’empêche pas les autres ampoules-individus d’émettre la même lumière environnementale. Le même environnement lumineux apparaît donc toujours aux autres individus-ampoules. Mais si l’ensemble des ampoules-individus s’éteint alors l’environnement lumineux commun s’efface et disparaît. Différents types d’êtres sensibles-ampoules émettent chacun une lumière dans une autre gamme de fréquence. Les différentes gammes de fréquence peuvent se chevaucher et la disparition d’un type d’êtres sensibles-ampoules n’empêche pas les autres types d’êtres sensibles-ampoules d’émettre et d’expérimenter leur environnement lumineux commun).
Notre existence détermine le schéma d’ensemble de notre Univers et réciproquement, le schéma d’ensemble de l’Univers rend notre existence possible. Les choses ou évènements n’existent pas intrinsèquement car ils existent par rapport à nous qui les définissons. Leur existence dépendant de nos désignations verbales et conceptuelles cela fait que le monde que nous expérimentons a un lien de parenté avec la pensée et le langage humain. Le langage crée le monde que nous expérimentons en même temps qu’il le reflète tout en le déformant. Le monde n’ayant pas une réalité extérieure toute faite et nos organes des sens interagissant avec « quelque chose » pour créer un monde, le langage joue donc un rôle important dans la création permanente et inconsciente de ce monde. En effet, pensée, langage et théories fragmentent le monde en choses séparées correspondant à tous les termes et distinctions utilisés dans nos descriptions de la réalité : ondes et particules, esprit et matière… (ach ! das ist duâlité). Les théories de la relativité et des quantas suggèrent que l’ensemble de l’Univers correspond à une « totalité indivisible », genre océan d’énergie, dont toutes les parties, y compris le scientifique et ses instruments, sont indissociablement liées. La distinction classique entre les particules matérielles et le vide a été abandonnée grâce aux théories des champs de la physique moderne.
Le vide n’a plus rien à voir avec le néant car il contient au contraire un nombre illimité de particules qui naissent et disparaissent sans fin. Les particules ne sont plus considérées comme des entités solides séparées de l’espace qui les entoure mais comme des concentrations d’énergie, des nœuds d’énergie, qui vont et viennent perdant ainsi leur caractère individuel et se dissolvant dans cette espèce de totalité-océan-d’énergie. Toutes les formes du monde particulaire et donc de la matière ne sont pas des entités physiques indépendantes mais des manifestations transitoires du vide fondamental sous-jacent. Le vide a une qualité dynamique, c’est un « vide vibrant » selon des rythmes infinis de création et de destruction, qui est le point de départ de toute chose dans l’Univers. Les physiciens ont découvert la qualité dynamique du vide (cf. la vacuité et la luminosité)
Se pourrait-il que les concepts de « vide » et
« d’énergie » chez les physiciens
aient un rapport entre
eux similaire à celui qui existe
entre les qualités
« vacuité » et « clarté-luminosité »
de l’esprit
fondamental ?!

Cette totalité-océan-d’énergie englobant tout ce qui existe depuis les particules élémentaires jusqu’aux galaxies en passant par le temps, l’espace, les pensées, les émotions, la conscience et l’énergie, est donc dynamique et fluide (cf. le dharmakaya à partir duquel se manifeste tous les phénomènes). Elle contient le Tout à la manière d’un hologramme car toute la réalité peut se révéler dans chaque partie de ce Tout. Par la pensée et le langage, nous fixons ce flot en y introduisant des distinctions séparant les choses les unes des autres et du même coup l’esprit et la matière.
Le langage fixe donc le monde et crée aussi des mondes nouveaux. Tout objet perçu est en fait extrait de cette totalité-océan-d’énergie : un son en est extrait grâce à l’ouïe, un micro-organisme en est extrait par la vue grâce au microscope, l’électron apparaît sous la forme d’onde ou de particule selon la façon dont il est extrait grâce aux instruments utilisés…C’est la conscience interagissant avec l’océan d’énergie grâce aux organes sensoriels qui produit les choses de notre monde. Nous partageons donc le même monde avec le reste de l’humanité parce que nos sens sont identiques et nos perceptions similaires. Des organes sensoriels différents nous offriraient un autre monde : essayer d’imaginer le monde perçu par les animaux ne percevant que 2 couleurs primaires au lieu des 3 (bleu, rouge, jaune) ou au contraire en percevant 4 (la 4ème pouvant être une sorte de pulsation ou vibration affectant les couleurs), ou celui perçu grâce aux ultrasons, ou encore celui perçu avec une vision plus rapide que la nôtre qui décompose les mouvements en séquences ralenties ou alors une vision plus lente qui décomposerait les mouvements en séquences saccadées… Construire un concept en rapport avec le monde extérieur pour le projeter ensuite sur celui-ci donne à ce concept une apparente indépendance par rapport au sujet concepteur. Notre expérience personnelle nous pousse ainsi à penser que les phénomènes perçus dans le monde extérieur existe indépendamment de nos perceptions et conceptions et nous croyons alors en un Univers objectif autonome par rapport à la conscience. Si on reprend l’exemple de l’électron, on voit que tout objet, chose ou phénomène conçu comme existant ne l’est qu’en fonction de certains caractères ou qualités qui le définit. Il possède ces attributs sans pouvoir être totalement assimilé à l’un ou l’autre d’entre eux. Bref son existence est de nature conventionnelle donc relative et non absolue. Aucun objet, fait physique, psychique ou autre n’a d’identité propre et n’existe de par sa nature, indépendamment de la désignation conceptuelle. Il semble exister par lui-même au niveau relatif mais au niveau ultime, absolu, il devient totalement inconsistant.

Cette position centriste correspond à une application contemporaine du Madhyamika (= voie du milieu en skt.) courant philosophique, institué par Bouddha mais dont l’un des principaux philosophes fut Nagarjuna (II-IIIème siècle) qui déclara « Les choses tirent leur nature d’une mutuelle dépendance et ne sont rien en elles-mêmes ». Il expliqua que la vérité ultime et la vérité conventionnelle-relative ne sont pas contradictoires mais complémentaires. Même si la plus petite parcelle concevable d’un atome n’existe pas sans condition (vérité ultime), la vérité conventionnelle-relative de la loi de causalité est indéniable. Cette philosophie porte sur le questionnement du mode d’existence des chôses dans leur essence et démontre le caractère illusoire et relatif de tous les phénomènes : c’est l’analyse « tout et parties ». Appliquons la à la notion de molécule : Une molécule est caractérisée par une masse, une charge, une taille et sa composition en atomes. Elle n’est pas identifiable à l’une ou l’autre de ses qualités ou parties car elle n’est pas identique à sa masse (sinon une masse possèderait une charge) ni à sa charge (sinon une charge possèderait une masse) et ne peut être assimilée à l’un de ses atomes. Elle ne correspond pas non plus simultanément à sa masse, charge et taille car rien n’existe qui puisse être tout à la fois la trompe de l’éléphant, ses oreilles et ses pattes, ces 3 entités ont des caractéristiques différentes et rien ne peut être les 3 en même temps. La molécule possède donc l’ensemble de ses caractéristiques mais ne peut pas « être » cet ensemble de caractéristiques puisqu’elle les « a » (on ne peut pas être identique à ce qui nous appartient !). Vidée de sa masse, charge…, la molécule n’en est plus une. L’ensemble de ses caractéristiques est une désignation conceptuelle qui ne fait référence à aucune réalité absolue ou ultime car la molécule n’a pas d’existence propre autonome. Bien sûr cela ne veut pas dire que la molécule est totalement dépourvue d’existence. Elle existe conventionnellement au niveau relatif en totale dépendance de ses caractéristiques mais n’a aucune existence intrinsèque au niveau ultime.
Autre exemple avec le Temps : la notion de temps est liée à celle de la durée. Toute période temporelle a une durée c'est-à-dire un début et une fin qui ne sont pas simultanées. Cette période temporelle n’est pas identique à son commencement sinon elle n’existerait plus au moment de sa fin et vice versa. N’étant ni son début ni sa fin, elle n’est pas non plus simultanément son début et sa fin. Elle n’est pas non plus l’ensemble achevé de son début, de son milieu et de sa fin sinon elle n’existerait pas à son début, ni à son milieu, ni à sa fin car l’ensemble achevé ne se présente pas à aucun de ces 3 moments. Cette période temporelle n’existe donc pas indépendamment de son début, de son milieu et de sa fin car elle pourrait alors exister en leur absence ! Son existence est donc purement conventionnelle au niveau relatif et n’a donc aucune réalité objective au niveau ultime.
Idem pour l’Espace qui, quelque soit l’angle de vue possible, possède un « avant » et un « arrière » qui ne sont pas assimilables. L’espace lui aussi n’est donc pas identique à l’une ou l’autre de ses parties ni à l’ensemble achevé de ses parties. Toutes les choses entretiennent donc des rapports de dépendance car elles sont indissociables de leur composants ou attributs. Ni identiques à leurs propriétés, ni viables en dehors d’elles, elles dépendent entièrement de ces qualités pour exister. Malgré leur existence totalement conventionnelle et leur absence d’identité intrinsèque au niveau ultime, les phénomènes s’influent réciproquement les uns les autres au niveau relatif car ils sont interdépendants (sacré tendrel, va !). Si les objets, les phénomènes existaient en eux-mêmes, ils seraient immuables et dans l’incapacité de subir ou d’exercer une influence quelqu’elle soit. C’est justement l’absence d’identité intrinsèque qui leur permet d’exister en interrelation avec d’autres entités. La distinction entre l’esprit subjectif et le monde objectif dépend entièrement de la désignation conceptuelle conventionnelle. Si les phénomènes physiques n’existent pas indépendamment des phénomènes cognitifs, il devient alors difficile de comprendre totalement les premiers sans prendre en compte les seconds.
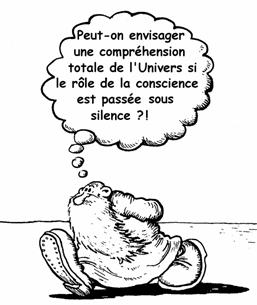
Scientifiquement parlant, les objets matériels se prêtent à des méthodes de mesure et d’analyse quantitative alors qu’il n’en est pas de même pour les phénomènes d’ordre cognitif (conscience, émotions, souffrance…) qui sont pourtant également dotés d’attributs, de propriétés ; la principale de ces propriétés étant bien sûr la conscience sous toutes ses formes. Il est possible pour les scientifiques d’observer les mouvements de l’esprit (le fait qu’il y est des pensées ou pas) en étudiant la circulation sanguine, les neurones du cerveau, les courants qui traversent notre corps mais ils ne peuvent pas voir la nature de l’esprit et ne peuvent tirer des conclusions que sur les mouvements constatés dans la relation de l’esprit avec le corps. La théorie de la Relativité a profondément modifié notre représentation de la matière car dans la physique classique, la masse d’un objet a toujours été associée à une substance matérielle indestructible. En fait la Relativité a montré que la masse n’est en rien une substance quelconque mais plutôt une forme de l’énergie (l’énergie étant une quantité dynamique, une activité). Même au repos, un objet contient de l’énergie emmagasinée dans sa masse, et le rapport entre les deux est donné par l’équation devenue célèbre E = mc2 (C étant la vitesse de la lumière). La masse d’une particule étant équivalente à une certaine quantité d’énergie, la particule ne peut plus être perçue comme un objet statique mais comme un modèle dynamique masse-énergie, un processus mettant en jeu l’énergie qui se manifeste elle-même comme masse.
Les implications mutuelles de la matière et de l’énergie de
l’Univers des physiciens
pourraient-ils être mis en parallèle
avec ceux existants :
entre le Corps de gloire-luminosité
(le
sambhogakaya, jaillissement spontané et constant) pour le
fonctionnement de l’énergie
et le Corps de manifestation
(le
nirmanakaya, cristallisation de l’énergie en forme et en
manifestation) pour la matière ?!

Pour la physique moderne, la plus importante des lois scientifiques est celle de la conservation de l’énergie : le couple masse-énergie passe par des séries de transformations sans avoir été créé à partir du néant et sans jamais cesser tout à fait d’exister. Pourquoi un principe comparable ne pourrait-il pas s’appliquer à la conscience ? Selon cette loi fondamentale de la conservation de l’énergie, toute nouvelle entité physique ou nouvelle combinaison particulière de masse-énergie est le résultat de transformation d’une autre combinaison de masse-énergie (rien ne se perd et rien ne se crée). Autrement dit, les phénomènes gardent quoiqu’il arrive un statut d’objet concret sous forme du couple masse-énergie, un composant matériel est transformé en un autre phénomène matériel. Dans l’hypothèse où un élément du cerveau serait à la source de la conscience cela voudrait dire qu’on aurait dans ce cas la transformation d’un composant physique en phénomène non physique car immatériel ! Tout le contraire du principe de conservation de l’énergie ! Bien que les mécanismes cérébraux influent sur les phénomènes psychiques (et réciproquement), les phénomènes psychiques n’ont pas une origine de nature physique. Le cerveau sert de support au fonctionnement de l’esprit, mais il n’est pas l’esprit ni ne le fabrique. La conscience ne naît pas d’une cause matérielle, la matière est une cause coopérante qui permet la manifestation de l’esprit sous sa forme grossière car dépendante du corps (cf. les 8 consciences). Le niveau grossier de l’esprit issu de l’interaction du cerveau, des neurones et des organes sensoriels ainsi que le niveau subtil adviennent de l’esprit très subtil qui en est la source.
Bref, l’immense variété des êtres sensibles pourrait-elle surgir du néant alors qu’aucune entité matérielle du monde physique ne se forme à partir de rien ? D’où viennent les phénomènes psychiques puisqu’ils ne sont pas issus du couple masse-énergie ni du néant ? Comme on l’a déjà vu, le bouddhisme explique que les états mentaux se forment selon un flux ininterrompu à partir d’états mentaux déjà existants de la même manière que les objets physiques se forment à partir d’objets physiques déjà existants. Le flux de conscience de tout être sensible ne s’anéantit donc jamais totalement mais se transforme et passe d’une incarnation à l’autre.
Mince, Bouddha a découvert
le principe de
conservation de la conscience, euréka !

La perte des souvenirs relatifs aux périodes de transition empêche la saisie de la continuité de la conscience qui se déploie en un flux ininterrompu (heureusement pour notre bocal qui serait vite encombré…) Des études bien menées sur les différents continents ont montré que jusqu’à l’âge de 4-5 ans, certains enfants, même de cultures différentes, gardent le souvenir de leur vie antérieure surtout si leur mort a été violente ou brutale. La mort s’accompagne d’un processus de rétraction, d’une part, des 5 énergies correspondant aux 5 familles de bouddha qui vont se condenser en « énergie vitale minimale discrète », et d’autre part, des différentes formes de conscience déjà vues (visuelle…) en « conscience discrète » (la conscience primordiale qui imprègne tout). La mort survient quand le couple énergie-conscience discrète quitte le corps. Ce couple énergie-conscience discrète est indestructible et ses composants sont indissociables, il serait donc plus adapté de parler d’une seule et même entité « le continuum énergie-conscience ». A ce niveau, la dualité entre phénomènes physiques et phénomènes psychiques a disparu. C’est ce continuum discret énergie-conscience qui se transmet à la vie suivante après une période intermédiaire correspondant au bardo du devenir. Il va participer à la fusion du spermatozoïde et de l’ovule et permettra à la cellule-œuf obtenue de se transformer en fœtus. L’aspect conscience de ce continuum, présent dès la conception, permettra l’apparition des consciences sensorielles et des facultés de cognition conceptuelle au cours du développement du fœtus. En parallèle, l’aspect énergie vitale discrète de ce même continuum va se différencier en les différentes énergies déjà vues plus haut.

|

|

|